| has abstract
| - . La religion écossaise au XVIIe siècle comprend toutes les formes d'organisations religieuses et de croyances dans le Royaume d'Écosse au XVIIe siècle. Au cours du XVIe siècle, l'Écosse avait subi une réforme protestante responsable de la création d'une Église nationale (Église d'Écosse) majoritairement Calviniste, aux perspectives fortement presbytériennes. Jacques VI favorisait la doctrine calviniste, mais aussi le système épiscopalien. Son fils Charles autorisa un livre de droit canonique qui fit de lui le chef de l'Église et imposa l'utilisation d'une nouvelle liturgie, considérée comme une version anglaise d'un livre de prières . En réponse à la rébellion les évêques écossais furent officiellement expulsés de l'Église et plusieurs représentants des différentes sections de la société Écossaise élaborèrent le Covenant National. Dans les guerres des évêques qui suivirent, les covenantaires écossais apparurent pratiquement comme d'indépendants souverains. L'échec de Charles I conduisit indirectement à la première révolution anglaise. Les covenantaires intervinrent en faveur du Parlement, et furent victorieux, mais se séparèrent de plus en plus du régime Parlementaire. Les défaites écossaises suivant les deuxième et troisième guerres civiles menèrent à l'occupation anglaise et à la fusion de l'Écosse avec le Commonwealth d'Angleterre, dirigé par Oliver Cromwell à partir de 1652, et également à l'imposition de la tolérance religieuse pour les protestants. Les covenantaires écossais se divisèrent en deux parties, les Résolutionnaires (en accord) et les Manifestants (en désaccord). Après la en 1660, l'Écosse retrouva son Église nationale, mais aussi l'épiscopat. Environ un tiers du clergé refusa d'accepter le nouveau règlement et en particulier les pasteurs du sud-ouest qui prêchaient ouvertement, en conventicule, attirant souvent des milliers de fidèles. Le gouvernement altérnait entre adaptation et persécution. En 1666 et 1679 plusieurs révoltes virent le jour et firent anéanties par les forces gouvernementales. La haute société qui continua à résister au gouvernement, connue sous le nom de cameroniens, devint de plus en plus radicale. Au début des années 1680, une phase de persécution plus intense débuta, laquelle fut connu dans l'histoire du protestantisme comme "The Killing Time". Avec l'avènement de Jacques VII, ouvertement catholique, l'inquiétude grandit parmi les protestants. Après la Glorieuse Révolution de 1688-89, Guillaume d'Orange et Marie, fille de Jacques, furent acceptés comme monarques. La décision finale restaura le presbytérianisme et destitua les évêques qui avaient en grande partie soutenu Jacques. Cependant, Guillaume, qui était plus tolérant que l'était l'Église écossaise fit adopter des actes ayant pour but de restaurer le clergé épiscopalien après la révolution. Le protestantisme était fondé sur la bible et le culte de la famille était fortement encouragé. Le consistoire contrôlait la discipline morale et personnelle. Il décourageait les célébrations de groupe. Le consistoire avait une charge administrative dans le système de secours aux pauvres, l'administration du système d'école paroissiale. Ils avaient également pris en charge les procès pour cas de sorcellerie. Le chasse aux sorcières la plus intense eut lieu en 1661-62, mais l'amélioration des conditions économiques et le scepticisme grandissant conduisirent à l'essoufflement de la pratique vers la fin du siècle. Le nombre de catholiques chuta et l'organisation de l'Église se détériora probablement, mais l'affectation d'un vicariat apostolique en 1694 inversa la tendance. (fr)
|


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)



![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
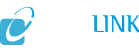







![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)